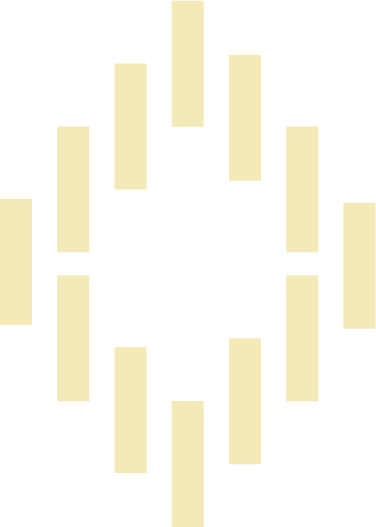
Les arantèles naphtaline s’estompaient dans ce vide, cet espace liminal où les dogmes d’une
monochromie pesante laissait bourdonner une dysphorie oscillante. Kafka disait : quand une
fois on a accueilli le mal chez soi, il ne demande qu’à ce que l’on lui fasse confiance. Cette
phrase m’a toujours rappelé un aphtegme, une aphorie désir que j’avais écrit dans une vieille
lettre, une qui n’a pas omis de me faire passer pour un des ténébreux torturés qu’illustre
Honoré ou alors aux amoureux sincères de Rohmer : « Si ce rouge sur ce mégot ne peut être
baumé et dissimulé par une cigarette, alors j’espère faire confiance au tien »
On jubile, entre ordre et chaos, aux risques de décevoir les baisers des alizées, la jalousie
d’une mer abyssale qui ne cesse de me draguer, à l’écume formant des miroirs reflétant mon
âme bleue et les glorieuses lumières d’un blanc sidéral, maintenant, aveuglé par son élégance,
comment mon avidité créative ne peut être que sombre. Je ne ressens qu’ivresse dans ces
endroit dénués de limites, aux frontières du néant et de l’obscurité jacente. La mélancolie
latente de ces endroits rémanents et vacants, dans une nuit moribonde ou l’accablant silence
envenimant ainsi une imagerie blanche en des formes draconiques noires naissantes et
ruinées. Les nappes aqueuses enrobaient toutes formes, mondaines ou non. Transpercé par des
glaives cupides et froids, le dragon se reposait dans l’agonie.
Le vent et la pluie cinglait sur la vitre brimée de divers graffitis et autres tags d’une jeunesse
intolérante et méprisante de ce petit bout de rien ferroviaire. Les rails trimballaient les
carcasses livides des toutes ces gens aux cœurs creux, à la mine grise, ce vieux monsieur au
trench bleu côtelé balbutiant à travers son masque, se plaignant du pauvre fléau
météorologique, à cette jeune lisant son journal pour ne lire que ces médias déblatérer sur la
même chose, pourtant son parfum arrivait à pénétrer à travers mon masque, une odeur forte,
sucrée, j’ignore encore pourquoi sa chemise à rayures semblait me faire penser à un simulacre
d’un Pierrot distribuant des barbes à papa à nos folles et ignares têtes blondes, destitués d’une
conscience commune sur la société qui nous entoure, proche des carrousel de la ville où j’ai
grandi. On me parle, j’ignore. Les noms des arrêts me bercent, je m’endors. Quinze, dix, cinq,
et terminus. Je sors en trombe ne regardant pas ce nuage de visages à la mine pâle, des
hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des roturiers, des collaborateurs, ce n’était pas la
première fois que je prenais ce train, et pourtant la même rengaine. Je reprends mon souffle
dans l’escalator, n’agissant que par pure réflex ataraxique, ne songeant qu’à moi-même
comme ces centaines de pantin. Dieu que ce quotidien est un agacement inconscient, je ne le
contrôle plus, et ce temps, j’en soupire. J’agitais ma sacoche, vérifiant son contenu, la
remettant droite sur mon jersey ocre et charbon. Je continuais dans ma marche, ne regardant
peu voire pas du tout les alentours, sautant les quelques marches qui me séparait des hauteurs
et du bord de mer. Je rigolais à l’idée de voir le tapis rouge salis par les traces de pas des
masses humaines traversant d’un instant mondain, temporaire ou au contraire
quotidiennement ce passage et qui comme moi avait cette petite pensée d’un défilé plus ou
moins prestigieux. Les voutes jonchaient au-dessus de ma tête aux cheveux éparses et
hirsutes, imbibés de la pluie salée de la côte. Le bruit des voitures, les pas sur les dalles
rocheuses, le bruit de l’eau d’une fontaine claquant sur le sol, les vibrations de mon téléphone
dans ma poche n’était qu’une empreinte d’une routine épisodique. Cette ville n’a cessé de me
faire penser à 1984 de Georges Orwell, les big brother sur chaque lampadaire de cette ville à
la mixité prolétaire et aux effluves luxueuses des escarpins rubis battant le sol et les flaques.
Les odeurs de différents restaurants et autres snacks, sur long du port formait une sorte de
melting-pot de saveurs, du sucré au salé, du gras au sain, je n’avais rien d’autre dans
l’estomac qu’un jus de fruit et de deux petites tasses d’un café acide et miteux, là étant, j’aurai
préféré encore chiquer le marc. J’aimais le marc, pour sa noirceur et sa teneur. Je le jetais
toujours machinalement dans ma poubelle, toujours en humant l’arôme restant, ce souvenir
d’une apostrophe comique et aigrie que j’aurai pu mettre en tant que panel à côté de ma
vieillerie de cafetière italienne, j’aimais la dire et redire comme un vieil oncle qui radote à
chaque repas.
Les marcs et les mœurs, ainsi que les j’en ai marre, je meurs.
J’observais les faisceaux lumineux sortant de petits diaphragmes célestes, reliant mer et ciel
comme les cordes d’une harpe fluctuante. La pluie était toujours là, elle rafraichissait mon
visage, et formait de petites perles azures dans ma barbe. La bise du vent plaquait mes
cheveux contre mon front suintant, je regardais les berlines projeter les flaques sur les
malheureux trop proches des trottoirs. J’accélérais le pas, je souhaitais être à l’abri, du temps
mais également de ce fléau que sont les mouvements de foules. Ne dédaignant pas mon sens
de l’orientation, je montais, sur cette pente, avec la vue d’une fourmilière démesurée sur ma
gauche, des pins et des cléomes instauraient une étrange signification théâtrale, elle agissait
comme un rideau, une ville comme décor et des comédiens plus ou moins talentueux. Dans ce
carnage, j’éclos, comme une fleur à l’aube, présomptueux de penser que je suis un metteur en
scène d’un théâtre philharmonique comme le Nogaku, respectant ses codes, chaque acteur se
voyant attribuer un masque, et derrière celui-ci encore un autre. Ce monde est cruel, mais il
n’a pas besoin d’être laid. Il s’est vu grandir de la saleté et la boue, comme une fleur de lotus,
il est beauté et il sera poésie. Comme le pensait Hegel, la réalité est une apparence plus
trompeuse que l’apparence de l’art. Mes pensées fusaient et se dispersaient dans mon esprit,
qu’en passant sous une petite tour, la lumière s’estompait, et la bruine se stoppa sur un petit
laps de temps qui me ramena à l’instant présent à repenser au poids du sac sur mon épaule,
aux muscles chauffant de la montée, aux odeurs de la pluie sur l’asphalte, aux arômes des
pins, aux bruits parasites des alentours. Ceci me fit revenir à moi-même, me menant ainsi
quelques mètres plus loin, à l’endroit où j’allais rester, je pénétrais par le portail, épiant les
alentours, il y avait à ma droite un espace parvis de petit gravier, on pouvait lire non loin sur
la façade du bâtiment crème et ocrée « Club Boulistes » , néanmoins, j’étais séparé de celui-ci
par un demi grillage, me forçant ainsi à traverser une nouvelles portes pour me faire
interpeller par un écran qui m’interpella d’une voix robotique qui prononça sèchement
« Authentification réussie » en affichant ma température corporelle sur l’écran, 35.7°, j’avais
pourtant chaud et j’haletais face à celui-ci, je soupirai, remarquant un bureau de secrétariat sur
ma gauche, vide, et un escalier que j’escaladerai à maintes reprises probablement. Je passais
une autre porte dans une salle beaucoup plus grande, remarquant un buffet de petit déjeuner
dans celui-ci, j’attrapais un gobelet cartonné et le remplissait de café. Pour pousser, plus tard,
à nouveau une nouvelle porte qui menait sur une petite terrasse qui j’ignore encore pourquoi
m’a fait penser à ces anciens péplums. Des palettes et des planches, des taules abîmées, des
tuyaux en plastique, des sacs de terres et des appareils placés contre les vitres et les piliers
cimentés scindaient et briser mon imaginaire de ce cadre romanesque. Curieusement, ces
objets rentraient dans une rime très antinomique avec un olivier charnu, et deux cèdres aux
formes cubiques ou phalliques ornées d’anémones blanches, ils étaient alignés dans ce patio
de façon aléatoire, entourés de dalles humides pour converger en son centre sur un mémorial
marbrée. Jeune, mon père, photographe, me disait souvent de voir ce que tout le monde voit,
mais n’y fait jamais attention. Elle n’avait jamais eu autant de sens que dans cette situation, la
plaque était là, une table en métal était posée dessus, des chaises pliantes autour comme si elle
était devenue un fragment réémanant de ceux qui étaient présents. Je jetais mon gobelet fini
dans une benne proche de l’entrée, rejoignant à nouveau une petite foule moins reprochable
écoutant les échos des rires, des discussions et des anticipations. Il y avait ce cœur muséal, ce
silence et ces murmures d’églises quand la porte se ferma. Quelques minutes passèrent,
sélectionnant les flux d’informations directes ou indirectes pour finir à nouveau par passer
dans l’escalier qui se dressait proche de l’entrée, affligé par la gravité de mon corps sur le sol,
le pas lourd je prolongeais d’une salle à un couloir, d’un couloir à une autre salle, des portes
fermées ou entrouvertes qui se laissaient deviner par un regard voyeur façon peep-show les
quelques ordinateurs et autres cyborgs. J’infiltrais cette salle inconnue, cet endroit un peu
holistique, m’asseyant sur une des chaises, rinçant de l’œil les quelques ouvrages déposées sur
le sol. La caféine pénétrant ainsi mon sang, me présentant, la marginalité des lectures qui
suivirent agissaient sur moi en tant que somnifère, intéressante mais soporifique. Les volutes
artistiques n’étaient pas conventionnelles, elles étaient dressées sur le sol à plat, il m’était
difficile de ne pas marcher sur les œuvres de l’artiste. Ma tête changeait de poids à chaque
balancement, de l’enclume au boulet de forçat, du moins c’est comme ça que je l’imaginais.
J’avais les mains liées à mon cou, comme dans un carcan. Le vert des arbres dehors
vacillaient, dansaient avec le sirocco baigné par une lumière un peu grisâtre. Je titubais sur
les œuvres, trépignant, caressant de la pointe de mes sneakers old-school, les imageries
originelles. Des esthétiques limitées qui n’était qu’autre qu’une imagerie imposée par l’artiste,
c’est à travers l'intention humaine avec les limites physiques et dimensionnelles que l'on
impose une image éternelle, que nous sommes capables de retrouver l'immobilité d'un
omniprésent et de ses variabilités, c’est de cette manière en tout cas que je le voyais. Plus mon
attention était plongée dans ces formes serpentueuses, plus l’image se révélait une direction
d'une clarté et d’une auguste reconnaissance. On ressent, comme une manifestation, une
représentation qui se retourne vers moi plutôt que de passer à travers moi - comme si elle était
omniprésente et résonnante. L'image devient uniquement une chose transcendante dans la
réalité expérimentée par le spectateur. Elle ne peut être diriger. L'image est sujette à toute
intégration, d'un petit ou grand degré, dans une réalité vécue par le sujet, qui dans un acte de
"regardeur" a déjà laisser l'image s'imprégner dans les réservoirs complexes de la mémoire, du
subconscient et des sentiments dont toutes les réalités subjectives sont construites avec une
fluidité automatique qui suggère ainsi l'absence de limite. Soupçonnant ainsi le lieu d’avoir
été impacté par Florence et ses Sybilles de Volterrano de la basilique de Santa-Croce.
Elle s’étendait là, bercée par une aura velours dans laquelle elle s’était drapée. Son visage
pâle, ses lèvres fines et grenat entre lesquelles se glissaient des mèches volatiles d’une
chevelure noire aile de corbeau. Un nez en bouton, rosie par le vent et la fraîcheur, des yeux
en amandes, d’un noir profond, miroitant les lumières vacillantes des alentours. Sa beauté
était unique, son parfum était divin, un mélange d’une odeur de pin et d’une source ruisselante
sur des pierres de Jade. Son regard était triste, mais sublimé par son apparence, son voile
entourait son visage d’une manière ostentatoire. Sa main délicate était posée au creux de ses
seins, ses vêtements n’étaient pas discernables mais sa chevelure onyx s’étendait éparsement
dans l’espace, me fixant comme une éclisse où je restais obnubilé par cette beauté torturante.
Un, six, quatre, cinq, sa deuxième main grelottante sur son koto liquide. Une forme écailleuse
émergea de l’eau, défiant elle-même la gravité, s’exhibant dans l’espace, rampante autour des
formes pour discerner deux yeux reptiliens écarlates détonnant avec ces squames blanc nacré.
La parure voilée se déforma en ce serpent qui par sa divination laisser entrevoir plusieurs
autres serpents, du même augure, seules les dimensions changeaient mais toutes entouraient
ce visage porcelaine à la fragrante bienveillance. Tous voguaient dans ces lames d’Ondines.
Brasser par le tumulte des étoffes aquatiques, elles se métamorphosaient par l’opacité
réfractrices des ondulations marines, se déversant en quelque chose de discernable mais se
modulant, se modifiant, s’ondulant, dans une symbiose incongrue dans ces strates vitreuses, à
chacun sa nouvelle vague, mais la mienne est d’Hokusai.
Différentes effluves, tantôt fortes, tantôt douces, parfois sucrées, parfois épicées me guidaient
vers des touffes florales déguisant des ossements, des crânes, humain ou animal. Je l’ignore,
j’avais des odeurs d’hortensias dans des dualités aromatiques constantes avec la poussière
s’illuminant avec les néons sur la droite. J’avais cette sensation d’être dans les diaboliques
corporations que fabule Phillip K. Dick, dans ces jardins artificiels, où la nature et la mort y
sont semés dans la fausse glèbe. Ces plantes étaient exotiques ou communes, colorées ou au
contraire fades. Mais elles formaient un genre de spirale qui s’aggloméra dans une image
vivante et naturelle, une femme. Une femme regardant dans une fenêtre d’évènements qui
sortait de mon champ de vision, prolongeant le mystère de l’ambiance mais aussi de la
continuité de cette atmosphère néfaste. Elle restait fixe, malgré le fait qu’elle était épiée. Ses
longs cheveux tombaient sur le bas de son dos, son rouge à lèvre luisait comme de
l’obsidienne, je ne pouvais voir le reste de son corps, mais elle avait à mes yeux une
apparence nymphéenne où coagulait l’éphémérité d’un bouquet floral qui l’encadrait. J’ignore
encore ce qu’elle observait, et ceci me hantait, elle avait des gestes maladroits mais un
effrontément très présent. Je ne pouvais que m’immiscer en tant que regardeur, contraint
d’observer cet opéra où la déviance des éléments se collait à brut, sur cette illustration
verdâtre aux pointes de couleurs rosées vivaces. Iimpétueux, déprimé et avec une insatiable
morbidité, cette floraison cupide de mort ne désirait que ma langue et mon palet, je la
croquais, au revoir au jardin de Nobuko.
Les fumées galvanisantes encrassaient mes poumons, l’écho des vrombissements et des
grondements profonds d’une caverne où les ombres disparaissent et les flashs se disséminent.
L’inconnu hadal instaurait un bruit blanc pesant, faisant pression sur mon corps en rendant
mes muscles immobiles et tremblant, livrant mon intérieur comme une énorme carcasse
caisson vibrante et dissonante, une ponctuation respirante un peu bâtarde autour de ce non-lieu stroboscopique. Les murs frissonnaient, de légères tâches rouge ardentes se répandaient
dans l’espace cohabitant avec la cendre déjà présente. Un spectacle intercalé entre deux
épaisses fumées de poix, chassé par des légères bises cherchant à s’enfuir dans cet univers en
pleine expansion. Le bruit n’était pas mobile, il restait fixe, sans jamais alterner l’écoute d’une
oreille et d’une autre, les sons étaient graves et vibrant, l’obscurité agrémentée de ces lucioles
enflammées installait dans cet endroit mystérieux une osmose cryptique. Difficile à dire ou
non, si ces tertres n’étaient que le fruit de mon imagination où s’ils étaient bien réels. Je me
sentais chasser de ce portail, mais je n’avais nul choix d’avancer, en faisant attention là où je
marchais. Le plafond semblait plus haut plus j’avançais, j’avais une sensation de vertiges
quand je l’observais. La touffeur se faisait plus présente, et la lumière était un peu plus
aveuglante. Quatre crocs se brandissent aussitôt du moment que je m’approchais, ces yeux de
jades brillaient par la puissance déflagrante qui sortait de sa gueule. Ses deux cornes
s’estompaient dans l’obscurité ne laissant deviner son envergure. Le Xuelong se brise.
Une proposition de Niky Abadie